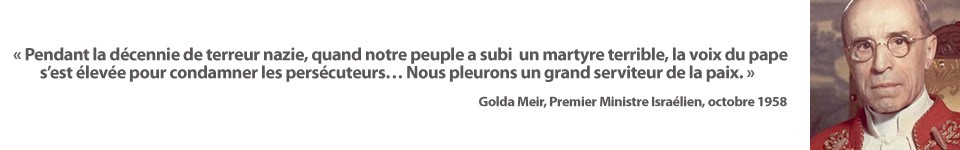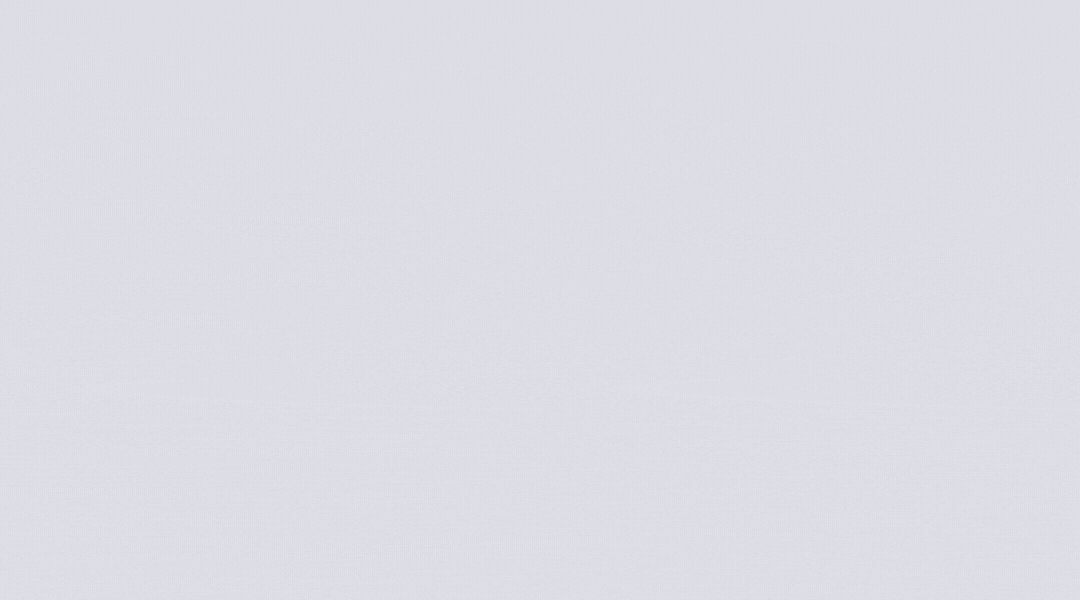Le livre de Hubert Wolf analyse l’action de Mgr Pacelli, futur Pie XII, avant 1939 à partir des archives du Vatican.
Hubert Wolf est un historien allemand reconnu, de l’université de Münster. La version française de son livre, sur les relations entre le Vatican, le nazisme et l’Allemagne hitlérienne, vient d’être publiée par les éditions du CNRS, sous le titre – beaucoup moins accrocheur qu’on ne pourrait le croire – Le pape et le diable. Ecrit à partir des sources d’archives du Vatican, désormais ouvertes pour le pontificat de Pie XI, il retrace près de vingt années de diplomatie pontificale dans sa confrontation avec le national-socialisme. Ce n’est donc pas à proprement parler un ouvrage sur Pie XII – contrairement à ce qu’affirme l’éditeur. L’étude s’achève en 1939 avec la mort du pape Ratti. Toutefois, la personnalité du nonce, puis du secrétaire d’Etat Pacelli domine l’essentiel du livre. L’ouverture des archives Pie XI offre une multitude de documents sur l’action du futur pape. Confirment-elles la vision négative colportée sur ce personnage central de l’histoire de l’Eglise du premier XXème siècle ?
Notons immédiatement que Hubert Wolf est tout sauf un historien amateur. Ces travaux sur l’histoire de l’Eglise font autorité. Il est un membre reconnu et respecté de la communauté scientifique des historiens. On comprend dès lors le ton pondéré, la justesse des analyses, l’exactitude des faits et le recours systématique aux archives référenciées qui jalonnent son texte.
Dans la longue et dense introduction, Hubert Wolf rappelle ce qui devrait être des évidences.
1. Depuis l’époque moderne, l’Eglise catholique lutte contre les prétentions de l’Etat à étendre sa souveraineté et sa domination à l’ensemble des corps sociaux et des institutions. Ce combat redouble d’intensité au XXème siècle avec l’émergence du phénomène totalitaire qui, par définition, ne peut tolérer l’autonomie d’une institution religieuse.
2. L’Eglise conçoit le monde comme structuré par le combat entre le Bien et le Mal, entre Dieu et Satan. Le pape est considéré comme le Vicaire du Christ. Ce n’est pas un simple mot. Il représente la bonté de Dieu sur Terre, et se doit de combattre le diable qui veut détourner les fidèles du droit chemin et compromettre leur salut. Le titre du livre est donc tout à fait approprié. Autant Pie XI que Pacelli ont été convaincus très vite de se retrouver, avec Hitler et ses sbires, face au Mal. La phrase de Pie XI, citée en introduction, prend alors tout son sens : « Quand il s’agit de sauver des âmes, de prévenir de grands maux capables de les perdre, Nous Nous sentons le courage de traiter même avec le diable en personne. » C’est ce que le Vatican a fait.
3. L’héritage de l’histoire allemande pèse dans l’esprit des décideurs ecclésiastiques. L’Allemagne est le pays de la Réforme, de la rupture avec Rome, où les protestants restent très nombreux et influents. Mais surtout le souvenir du Kulturkampf reste prégnant, et avec lui celui de la persécution des catholiques par Bismarck qui les a privés de prêtres et de sacrements. Il faut donc agir avec une infinie prudence.
La profonde connaissance de Hubert Wolf sur l’histoire de l’Eglise, sur son fonctionnement, sur ses divisions, mais aussi sur le dogme catholique donne toute leur qualité à ses analyses. De cette étude rigoureuse Pacelli ressort lavé des accusations d’antisémitisme et de complaisance pour le national-socialisme. Pourquoi ? Parce que les archives prouvent indubitablement la fragilité, et surtout la fausseté, de ces attaques.
Le portrait tracé de Pacelli est tout en nuances. Wolf le décrit comme un antimoderniste convaincu, rejetant le monde moderne et ses valeurs, parce qu’elles sont intrinsèquement opposées à celles du catholicisme. Sur ce point, aucun compromis possible. Pacelli est un défenseur implacable de la doctrine et de la société catholiques. Mais, de nouveau, Wolf replace l’analyse dans le contexte. Pas plus Pie XI que Pacelli ne sont issus de l’Eglise conciliaire. Ils vivent dans un monde où l’idée d’oecuménisme avec les protestants, de dialogue interreligieux, pour ne pas dire de relativisme religieux, est proprement absurde. Hors de l’Eglise catholique, point de salut. L’attachement de Pacelli au centralisme romain ne souffre d’aucune ambiguïté. D’où sa lutte contre les évêques allemands nommés par l’Etat. Pour autant, sa rigidité doctrinale ne l’empêche pas de défendre des positions de compromis quand il le faut. Ainsi parvient-il à mettre de côté la condamnation voulue par le Saint-Office du mouvement œcuménique catholique allemand, en 1928, parce que la situation politique en Allemagne et les intérêts du Saint-Siège le commandent.
Les chapitres consacrés au Concordat de 1933 et à la position du Vatican face à la persécution des juifs en Allemagne apportent des informations précises sur la politique suivie par Pie XI et son secrétaire d’Etat. Il ressort des documents archivistiques que la papauté accorde un certain crédit à Hitler en 1933. Sans suivre les indications du nonce Orsenigo – Wolf le décrit avec raison comme un « agent peu fiable » (p.167) – qui voit dans le Führer l’archétype d’un national-socialisme acceptable, Pie XI est sensible à l’anticommunisme viscéral du nouveau chancelier et à ses déclarations publiques apaisantes à l’égard de l’Eglise. Une rencontre avec Hitler, en audience privée, est même envisagée. Mais là aussi, il faut insister, peut-être plus que ne le fait Wolf, sur l’importance du contexte. Personne, dans les premiers mois de 1933, n’est capable d’imaginer l’intensité des persécutions et du crime sans aucun précédent historique qui s’abattront sur les juifs et les opposants au régime. D’ailleurs, Wolf précise bien que Pie XI, dès cette année 1933, prend la mesure de la violence du nouveau régime, puisque, en décembre de la même année, il envisage une protestation publique en cas d’attaques contre les associations catholiques.
D’une façon indubitable, Wolf exempte Pie XI et Pacelli de toute intervention directe et même indirecte dans le vote des pleins pouvoirs à Hitler par le Zentrum et dans la levée de l’interdiction faite aux catholiques allemands de participer au national-socialisme. Dans les deux cas, il s’agit d’une initiative des évêques allemands. De plus, Pacelli regrette la façon dont ces derniers ont procédé. Ils ont, selon lui, accorder à Hitler d’incontestables atouts sans aucune contrepartie. Bien au contraire, le secrétaire d’Etat aurait d’abord obtenu « un Concordat garantissant la pastorale catholique, l’école confessionnelle et les associations et organisations catholiques », pour ensuite faire des concessions à Hitler. On voit à quel point le diplomate Pacelli cherche à défendre l’Eglise et sa pastorale. C’est pourquoi il regrette l’autodissolution du Zentrum, le 5 juillet 1933, effectuée avant la signature du Concordat, et qui le prive d’un « atout décisif » dans les négociations avec Berlin.
Il est clair que le Concordat procède d’une initiative du pouvoir nazi avec le soutien de l’épiscopat allemand. Au fil des pages qui y sont consacrées, plusieurs points ressortent :
– la volonté très forte de protéger les catholiques allemands face à un Etat totalitaire qui, par définition, veut soumettre l’individu dans la masse. C’est un dessein identique qui animait Pie XI, dans les années 1920, pour signer un Concordat avec l’Union soviétique.
– la netteté avec laquelle Pacelli explique que le Concordat ne peut, en aucune façon, être interprété comme une reconnaissance de l’idéologie du régime.
– l’absence de toute illusion chez Pacelli, voire sa clairvoyance à propos de Hitler. Citons le rapport du chargé d’affaires anglais auprès du Saint-Siège en août 1933, suite à une audience chez le secrétaire d’Etat : « le cardinal Pacelli déplorait les méthodes du gouvernement allemand en matière de politique intérieure, sa persécution des juifs, ses mesures contre les opposants politiques, le régime de terreur auquel la nation toute entière était soumise ». Pacelli ne croit absolument pas à une modération de la part des nazis. « Nous verrons, dit-il, qu’avec chaque année qui passe son pouvoir le rendra plus extrême et d’un commerce plus difficile » (p.185). Ce qui est en jeu pour Pie XI et son collaborateur, c’est la survie de l’Eglise en Allemagne. En réalité, face à un pouvoir si démoniaque, les alternatives sont rares. Avec le Concordat, le Vatican possède un instrument juridique précieux. Andrea Tornielli a montré, dans son livre, comment Pacelli s’en est servi pour dénoncer les agissements des nazis.
Au sujet de l’antisémitisme, le livre apporte de nombreuses réponses aux questions autour de Pacelli. Il met en pièces plusieurs des thèses les plus farfelues. Le chapitre consacré au projet de réformes de la prière du vendredi saint sur les « juifs perfides » ne concerne pas directement Pacelli puisqu’il n’y a pas pris part. Il montre en revanche les divisions profondes au sein du monde catholique, et du Vatican en particulier, entre les tenants de son maintien et ceux qui appellent à sa disparition et au rapprochement avec le judaïsme. Cette recherche, absolument passionnante, rend bien ridicules les thèses qui font des catholiques des antisémites. Toutefois, Wolf reste très sévère dans son jugement sur l’antisémitisme chrétien en général, et sur Pie XI en particulier qui n’a pas voulu de la réforme (p.125-126). Il est incontestable que l’antijudaïsme traditionnel imprègne encore de nombreux cercles de l’Eglise. Les documents préparatoires à la fameuse encyclique contre le racisme et l’antisémitisme en portent d’ailleurs la marque. Rajoutons néanmoins une autre évidence. Lors des rafles de Rome en octobre 1943, les juifs se réfugient dans les couvents catholiques qui leur ouvrent leurs portes et les sauvent de la mort.
Au sujet de Pacelli, Wolf est d’une clarté limpide. Il n’y a chez lui aucune trace d’antisémitisme racial. Au contraire, le cardinal perçoit « la responsabilité générale de l’Eglise en matière de droits humains ». Le livre de Wolf renvoie en fait à une question cruciale et lourde de sens : que faire ? Que peut faire le Vatican en faveur des juifs ? De quels instruments dispose-t-il ?
Le Concordat ? Il ne concerne que les catholiques et toute prise de position en faveur des juifs relève, juridiquement, d’une immixtion dans les affaires intérieures de l’Etat. Les nazis auraient pu s’en servir pour rompre le Concordat et lancer des persécutions contre les catholiques. C’est, on le sait, le dessein nourri par Hitler (voir notre texte sur le blog à propos du Journal de Goebbels).
Les interventions diplomatiques ? Wolf cite un exemple très éclairant. En novembre 1933, Mgr Orsenigo tente d’intervenir en faveur d’une famille catholique issu du judaïsme à la troisième génération. Du fait des lois de Nuremberg, le fils perd son emploi dans la fonction publique et la fille ne peut épouser son fiancé. La demande de dérogation du nonce est rejeté (p.206). Pour les nazis, on est juif par la race et rien ne peut y changer. On voit la faible marge de manœuvre dont dispose l’Eglise face à un tel pouvoir.
A défaut d’archives, Wolf reste très prudent sur le silence de Pie XI au moment de la Nuit de cristal. Il met en tout cas en avant l’évolution du pape qui s’engage vers la dénonciation de plus en plus virulente du fascisme et du nazisme. Le dernier chapitre est consacré aux travaux du Saint-Office à propos d’un projet de Syllabus dénonçant les nouvelles erreurs du temps : l’idolâtrie de l’Etat et de la race, le rejet du christianisme et les attaques contre l’éducation catholique. Fort avancé, ce projet est finalement enterré par Pie XI mais repris très fortement dans l’encyclique Mit brennender Sorge. De plus, si Le mythe du XX° siècle de Rosenberg est mis à l’Index en 1934, ce n’est pas le cas de Mein Kampf. L’explication se trouve, une fois encore, dans les traditions de l’Eglise qui ne condamne pas les chefs d’Etat et n’appelle pas à la désobéissance civile. Alfred Rosenberg n’est pas Hitler. Wolf ne reprend pas à son compte les élucubrations sur Pacelli à propos de l’abandon du projet de discours de condamnation du fascisme que Pie XI aurait dû prononcer, le lendemain de sa mort. En tant que camerlingue, il n’a pas à le faire. En tant que nouveau souverain pontife, il opte pour une autre stratégie. Avec des phrases très fortes, Wolf rappelle certes l’influence du diplomate, de l’homme de compromis. Mais la vérité est ailleurs. Pie XII est attaché, depuis 1917, à l’idée de la neutralité politique du Vatican parce que les Etats lancés dans une guerre totale rejettent toute intervention papale. Et surtout parce qu’il est le chef de l’Eglise universelle, « ‘le padre comune’ de tous les fidèles catholiques ». Ce que peut faire un évêque allemand (Galen, Preysing) est, de fait, interdit au pape. Aucune naïveté chez Pie XII quant aux résultats des protestations publiques. Il a, comme le note Wolf, « les mains liées ». Au moins publiquement.
Quelques points auraient mérité des analyses plus approfondies :
– La crise révolutionnaire en Bavière à laquelle Pacelli est confronté en 1918-1919.
– Le poids de l’hostilité au national-socialisme dans la lenteur avec laquelle le Vatican accepte de reconnaître le gouvernement du général Franco jugé trop proche de Berlin.
– Le rôle majeur que Pacelli joue dans la rédaction de l’encyclique Mit brennender Sorge.
Une telle étude souffre de l’absence d’une conclusion. Elle confirme en tout cas l’inanité des accusations d’antisémitisme et de sentiments pronazis faites à l’encontre de Pacelli. Il n’existe aucun document prouvant des sentiments de rejet, voire de haine à l’encontre des juifs. L’étude d’Andrea Tornielli, sans doute sous-utilisée ici, apporte sur ce point des indications précises sur la bienveillance de Pacelli à leur égard.
Les détracteurs de Pie XII ne cessent de parler des secrets encore enfouis dans les archives du Vatican. Le livre de Wolf annonce une grave déception. Il confirme une tendance qui ne cesse de s’affirmer. Les archives attestent de la connaissance très fine de Pacelli du national-socialisme, son hostilité profonde à l’égard de cette idéologie, de son antisémitisme racial et de son antichristianisme. Plus que jamais Pie XI comme Pie XII apparaissent comme des pasteurs désireux de protéger leur troupeau mais aussi l’ensemble des êtres humains rabaissés et persécutés par le pouvoir hitlérien. Pour ce faire, le compromis et les discussions leur semblent le meilleur moyen. Peut-on le leur reprocher ? Le Vatican est un Etat qui négocie avec l’Allemagne, comme le font les autres Etats européens. Wolf aurait ainsi pu rappeler qu’en 1933, année du concordat, la France et le Royaume-Uni signent avec Berlin le Pacte à quatre, autre succès diplomatique pour le nouveau pouvoir.
Toutefois, diront ses détracteurs, le pape, Vicaire du Christ sur Terre, peut-il négocier avec un Etat clairement opposé à ses propres valeurs ? Pacelli serait-il plus diplomate que pasteur ?
Il faut bien comprendre que les deux éléments sont indissociables dans l’action comme dans l’esprit du Souverain Pontife. Il est chef d’Etat – le Vatican – et chef religieux – l’Eglise catholique. Il se doit de défendre les valeurs du catholicisme et les catholiques, et en même temps les intérêts du Vatican. Mais les deux sont liés. Pourquoi ? Parce que la défense de la structure étatique du Vatican n’est pas une fin en soi, mais un instrument afin de parvenir au premier des buts, à savoir la défense de la foi. Et c’est particulièrement net dans le cas de Pie XII. Le maintien de relations diplomatiques correctes, y compris avec les ennemis de la foi, est jugé nécessaire pour sauver les persécutés. Signer donc, y compris avec le diable.
Et si on en parlait ensemble ? (Chat' anonyme et gratuit)